« AMF cartographie des risques » : c’est quoi au juste ?
Chaque année, l’AMF (Autorité des marchés financiers) publie une cartographie des risques. On peut la comparer à une grande carte qui montre l’état des marchés financiers : les points solides, les zones fragiles et les dangers qui pourraient se transmettre d’un secteur à l’autre.
Dans son édition 2025, l’AMF s’appuie sur les données disponibles jusqu’à fin juin. Elle étudie plusieurs sujets importants qui peuvent avoir un impact direct ou indirect sur l’épargne des particuliers :
- la politique monétaire (hausse ou baisse des taux d’intérêt),
- les tensions commerciales (comme les droits de douane),
- la santé des marchés financiers (actions, obligations, liquidité),
- les innovations et leurs risques (crypto-actifs, cyberattaques),
- les comportements d’épargne des ménages.
L’objectif est d’aider aussi bien les professionnels que les particuliers à identifier les risques, comprendre leurs mécanismes et savoir lesquels surveiller en priorité. Autrement dit, c’est une référence utile pour toute personne qui veut mieux gérer son patrimoine et prendre des décisions éclairées.
Table des matières
Le décor macro-financier de 2025 : entre tensions commerciales et jeux de taux

Vous souhaitez adapter votre portefeuille aux risques identifiés par l’AMF ? Prenez rendez-vous avec un expert en allocation d’actifs et sécurisez vos choix
Le printemps 2025 a été marqué par un épisode brutal. Le 2 avril, les États-Unis annoncent de nouveaux droits de douane « réciproques ». Cette décision a agi comme une étincelle sur la poudre des marchés : en l’espace d’une semaine, le CAC 40 s’est enfoncé de près de 12 %, avant de reprendre son souffle grâce à un moratoire et l’ouverture de négociations. Cet aller-retour illustre à quel point les places financières restent sensibles aux annonces politiques et aux incertitudes du commerce international.
Dans le même temps, les banques centrales ont poursuivi des trajectoires très différentes. En Europe, la BCE a choisi d’assouplir largement sa politique : depuis juin 2024, elle a abaissé ses taux directeurs à huit reprises, les ramenant à 2 % en juin 2025. De l’autre côté de l’Atlantique, la Réserve fédérale a décidé de s’arrêter plus tôt, maintenant son taux à 4,5 % depuis décembre 2024. Ce contraste crée une sorte de décalage entre les deux économies, qui influence directement le financement des États et des entreprises.
Les marchés obligataires, eux, n’ont pas été en reste. Le rendement de l’emprunt allemand à dix ans, le fameux Bund, a progressé d’environ un demi-point depuis la fin 2024. Plus surprenant encore, la hiérarchie habituelle des taux en Europe s’est trouvée bousculée : l’Espagne et le Portugal parviennent désormais à emprunter à des conditions plus favorables que la France. Une inversion symbolique, révélatrice des dynamiques nouvelles qui traversent la zone euro.
Ce qu’il faut retenir, c’est que dans cette cartographie des risques de l’AMF 2025, les tensions commerciales sont identifiées comme un déclencheur majeur de volatilité. Elles s’ajoutent à un paysage financier déjà contrasté, où les décisions divergentes des banques centrales dessinent un terrain mouvant, à la fois incertain et riche en enseignements pour les investisseurs comme pour les épargnants.
Marchés : une résilience affirmée, mais des fragilités en filigrane

Construisez votre assurance vie sur mesure dès aujourd’hui : prenez rendez-vous avec un expert.
Les actions
La violente secousse d’avril aurait pu laisser des traces durables. Pourtant, à peine quelques semaines plus tard, plusieurs indices boursiers avaient retrouvé, voire dépassé, leurs sommets précédents. Ce rebond s’est nourri d’anticipations macroéconomiques plus favorables et de résultats solides dans certains secteurs. Mais cette vigueur a un revers : les marchés se paient désormais cher, avec des valorisations élevées et une prime de risque réduite. Autrement dit, la moindre mauvaise surprise (qu’elle soit économique ou géopolitique) pourrait suffire à ranimer la nervosité.
Les obligations
Du côté des dettes d’entreprise, l’activité est restée intense. Le segment le plus risqué, le high yield, a atteint près de 450 milliards d’euros en 2024, soit une progression de 70 % par rapport à l’année précédente. Et malgré la quasi-paralysie du marché au mois d’avril, la dynamique s’est prolongée en 2025.
Les obligations durables (qu’elles soient vertes ou sociales) ont, elles aussi, connu une année florissante : environ 900 milliards d’euros d’émissions en 2024, dont 60 % sous forme d’obligations vertes. La France y a fortement contribué, avec près de 50 milliards d’euros levés, soit une hausse spectaculaire de 70 % en un an. Le début de 2025 montre toutefois un léger essoufflement.
Le monétaire
Enfin, les fonds monétaires n’ont pas subi la panique que l’on pouvait craindre. Lors du choc d’avril, aucun mouvement massif de retraits n’a été observé. Au contraire, ils ont même enregistré une collecte positive, avoisinant 13 milliards d’euros entre le 1?? et le 12 avril, un chiffre comparable à ce qui s’était produit les années précédentes à la même période.
En résumé : les marchés financiers ont prouvé leur résilience. Mais derrière cette solidité apparente se cachent des tensions : des actions sensibles à la moindre secousse, des obligations dynamiques mais vulnérables aux chocs, et des fonds monétaires solides mais toujours exposés aux crises de confiance.
AMF cartographie des risques : Gestion d’actifs, ce qui résiste… et ce qui inquiète

Testez notre simulateur d’épargne et projetez-vous dès aujourd’hui.
Les fonds monétaires
En 2024, les gérants de fonds monétaires ont ajusté leurs portefeuilles au gré des vents politiques et économiques. Au premier semestre, ils avaient choisi d’allonger la durée de leurs placements, profitant d’un environnement relativement stable. Mais, à l’approche des incertitudes politiques de la fin d’année, ils ont préféré raccourcir leurs maturités pour réduire les risques. À partir du quatrième trimestre, la situation s’est stabilisée.
Au printemps 2025, même le choc d’avril n’a pas brisé cette dynamique : les fonds ont continué à voir leurs encours croître, grâce à la fois aux apports des investisseurs (collecte) et à l’évolution favorable de leurs valorisations.
Le risque de liquidité
Tout n’est pourtant pas exempt de fragilité. Certains segments restent vulnérables, notamment l’immobilier non coté ou les obligations à haut rendement. Ce sont des marchés qui fonctionnent bien en temps calme, mais qui peuvent devenir très difficiles à vendre ou à refinancer lorsque la tempête souffle. Le mois d’avril l’a rappelé : en période de forte volatilité, les écarts de taux (« spreads ») se creusent brutalement et les investisseurs peuvent se retrouver piégés dans des actifs difficiles à céder rapidement.
En clair : la gestion d’actifs a montré sa robustesse, mais derrière cette stabilité apparente se cachent des zones plus fragiles, prêtes à se tendre si les marchés connaissent un nouveau choc.
Les épargnants français en 2024-2025 : plus audacieux, mais pas toujours conscients des risques
Un taux d’épargne toujours élevé
Les Français continuent de mettre beaucoup d’argent de côté : environ 19 % de leur revenu, un des niveaux les plus élevés en Europe. Plus de la moitié de cette épargne va désormais vers des produits financiers (et non plus uniquement vers l’immobilier ou les livrets). L’assurance vie reste particulièrement attractive, d’autant plus que les taux réglementés ont diminué, poussant les ménages à chercher de meilleurs rendements ailleurs.
Fait marquant : près de 30 % des personnes interrogées déclarent vouloir acheter des actions dans les douze prochains mois – un niveau record. En parallèle, environ 8 % des Français détiennent déjà des crypto-actifs, preuve d’un intérêt croissant pour ces placements plus risqués.
La montée en puissance des ETF
Les ETF (fonds indiciels cotés en Bourse) connaissent un véritable boom. Le nombre de transactions réalisées par des particuliers a doublé en 2024 (de 266 000 à 530 000 par mois), puis a triplé entre janvier 2024 et mars 2025, atteignant 846 000 transactions mensuelles.
Ce mouvement est porté par l’arrivée des neobrokers (applications de courtage en ligne), qui ont conquis une part de marché grandissante : de 16 % des transactions début 2024, ils en représentent déjà 28 % début 2025. Les jeunes investisseurs, notamment les moins de 35 ans, sont particulièrement actifs dans cette tendance.
ETF complexes : un repli bienvenu
Les ETF dits « complexes » – à effet de levier ou inverses – qui multiplient ou inversent la performance d’un indice sur une base quotidienne, ne représentent plus que 5 % des transactions début 2025. Ce recul est plutôt positif : il montre que les investisseurs prennent davantage conscience de la différence entre des ETF classiques, adaptés à un investissement de long terme, et des ETF complexes, qui relèvent davantage du trading court terme et nécessitent une bonne maîtrise technique.
En résumé : les Français épargnent toujours beaucoup, mais ils se tournent de plus en plus vers des placements dynamiques, comme les actions et les ETF. C’est une évolution saine, à condition de bien comprendre les produits choisis et de garder en tête la différence entre une stratégie de long terme et des paris plus spéculatifs.
Crypto et innovation : des liens de plus en plus étroits avec la finance traditionnelle
Les stablecoins, un pont fragile vers le système financier
Les stablecoins, ces crypto-actifs censés suivre la valeur d’une monnaie traditionnelle comme le dollar, continuent de prendre de l’ampleur. Leur capitalisation est passée de 130 milliards de dollars début 2024 à 203 milliards fin 2024, avant d’atteindre un pic de 234 milliards à la mi-avril 2025.
Le marché reste cependant très concentré : à eux seuls, l’USDT (Tether) et l’USDC pèsent environ 86 % du total. Derrière leur apparente stabilité se cache un enjeu majeur : les actifs utilisés en garantie (bons du Trésor américains, dépôts en dollars) créent une connexion directe entre la sphère crypto et la finance traditionnelle. En cas de crise de confiance, cette interconnexion pourrait devenir un canal de contagion.
Les ETF actions, un basculement géographique
Sur les marchés financiers plus classiques, on observe aussi des évolutions intéressantes. Jusqu’à début 2025, les investisseurs européens privilégiaient largement les ETF exposés aux actions américaines. Mais à partir de fin janvier 2025, la tendance s’est inversée : les flux se dirigent davantage vers les ETF centrés sur l’Europe.
L’épisode d’avril a confirmé ce basculement : alors que les ETF européens investis sur les États-Unis ont subi des sorties de 4,2 milliards d’euros, ceux investis sur l’Europe ont enregistré des entrées de 1,3 milliard d’euros. Une façon, pour les investisseurs, de réduire leur dépendance aux chocs venus d’outre-Atlantique et de miser davantage sur la résilience du marché européen.
En résumé : qu’il s’agisse des stablecoins ou des ETF, l’innovation financière crée de nouveaux ponts entre marchés traditionnels et actifs émergents. Ces connexions offrent des opportunités, mais elles peuvent aussi amplifier les crises si la confiance venait à se fissurer.
Opérationnel & cyber (DORA) : le risque « silencieux » mais systémique

Vous souhaitez adapter votre portefeuille aux risques identifiés par l’AMF ? Prenez rendez-vous avec un expert en allocation d’actifs et sécurisez vos choix
Tous les risques financiers ne s’expriment pas à travers les cours de Bourse ou les taux d’intérêt. Certains, plus discrets, se nichent dans les coulisses du système : ce sont les risques opérationnels et cyber.
Ces derniers mois, plusieurs incidents ont rappelé leur réalité très concrète : des perturbations sur T2S, la plateforme européenne de règlement-livraison des titres ; des coupures d’électricité affectant l’Espagne et le Portugal ; ou encore le piratage de la plateforme crypto Bybit. Autant d’événements qui montrent que l’infrastructure sur laquelle repose la finance moderne est loin d’être invulnérable.
Le secteur financier est d’ailleurs l’une des cibles privilégiées des cyberattaques, avec les banques en première ligne. Face à cette menace, l’Union européenne a décidé de renforcer son arsenal. Depuis janvier 2025, le règlement DORA (Digital Operational Resilience Act) est entré en vigueur. Il impose aux acteurs financiers – et à leurs prestataires technologiques critiques – des règles beaucoup plus strictes : cartographie des dépendances, tests de résistance, gestion et reporting d’incidents.
En clair : le risque cyber ne fait pas la une des journaux aussi souvent que les variations du CAC 40, mais il peut déstabiliser tout le système en silence. Avec DORA, l’Europe tente d’ériger un rempart, conscient qu’une faille informatique ou énergétique pourrait avoir des conséquences aussi lourdes qu’une crise financière.
Implications pratiques : ce que professionnels et épargnants peuvent retenir
Diversification des placements
La première règle reste de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Une allocation saine doit éviter les concentrations trop fortes sur un pays, un secteur ou un style d’investissement. Les professionnels, comme les particuliers avertis, gagneront à revisiter leurs scénarios de crise (« stress tests ») en intégrant des hypothèses de chocs plus larges, notamment sur l’écartement des spreads obligataires.
Préserver la liquidité
L’horizon 2026–2028 s’annonce comme un véritable mur de refinancement pour de nombreuses entreprises et États. Dans un tel contexte, il est essentiel de surveiller de près sa liquidité : disposer de réserves de cash ou de collatéraux permet d’absorber les secousses lors des périodes de forte volatilité.
Bien utiliser les ETF
Les ETF « classiques » dits plain vanilla, sont de précieux outils pour construire un portefeuille de long terme, simple et diversifié. En revanche, les ETF « complexes » (à levier ou inverses) doivent rester l’apanage de stratégies tactiques, limitées dans le temps, et encadrées par une bonne compréhension juridique et technique. Confondre les deux peut mener à des déconvenues.
Renforcer la cybersécurité
Le règlement européen DORA impose aux institutions financières de nouvelles obligations en matière de résilience opérationnelle. Même les acteurs qui ne sont pas directement concernés peuvent s’inspirer de ses principes : meilleure gestion des fournisseurs, tests réguliers de résistance, protocoles clairs de signalement d’incidents. Ces bonnes pratiques contribuent à élever le niveau global de sécurité face aux risques cyber.
En résumé : investir aujourd’hui suppose d’allier prudence et lucidité. Diversifier, garder de la liquidité, comprendre les outils que l’on utilise et ne pas négliger les menaces invisibles comme le cyber : ce sont les conditions pour traverser sereinement les années à venir.
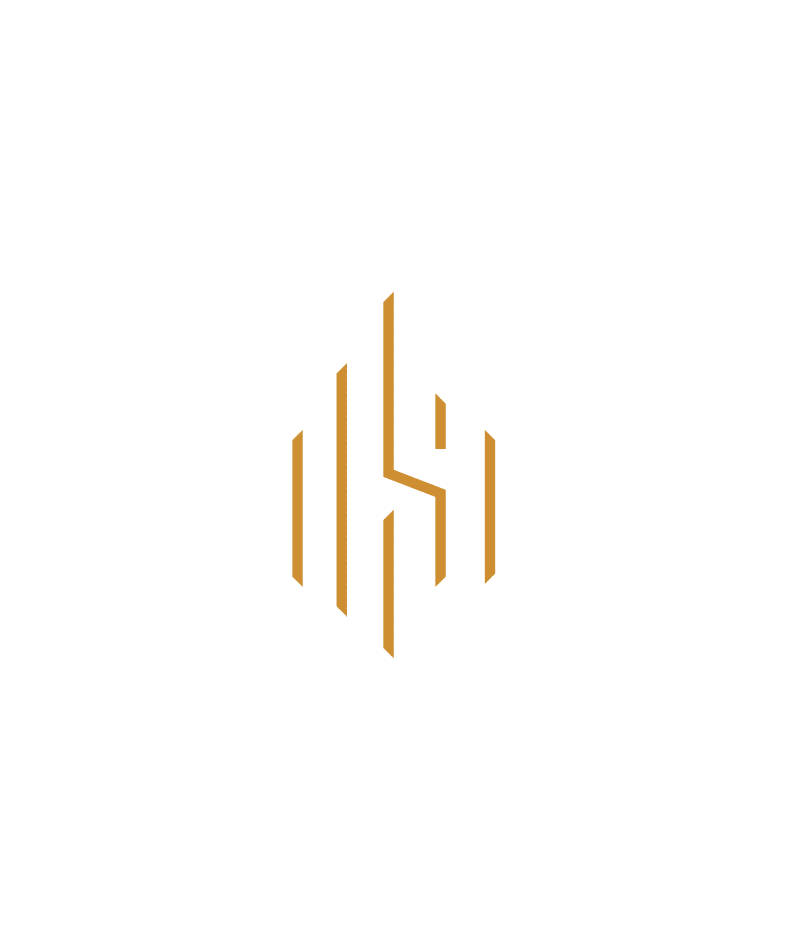






Laisser un commentaire