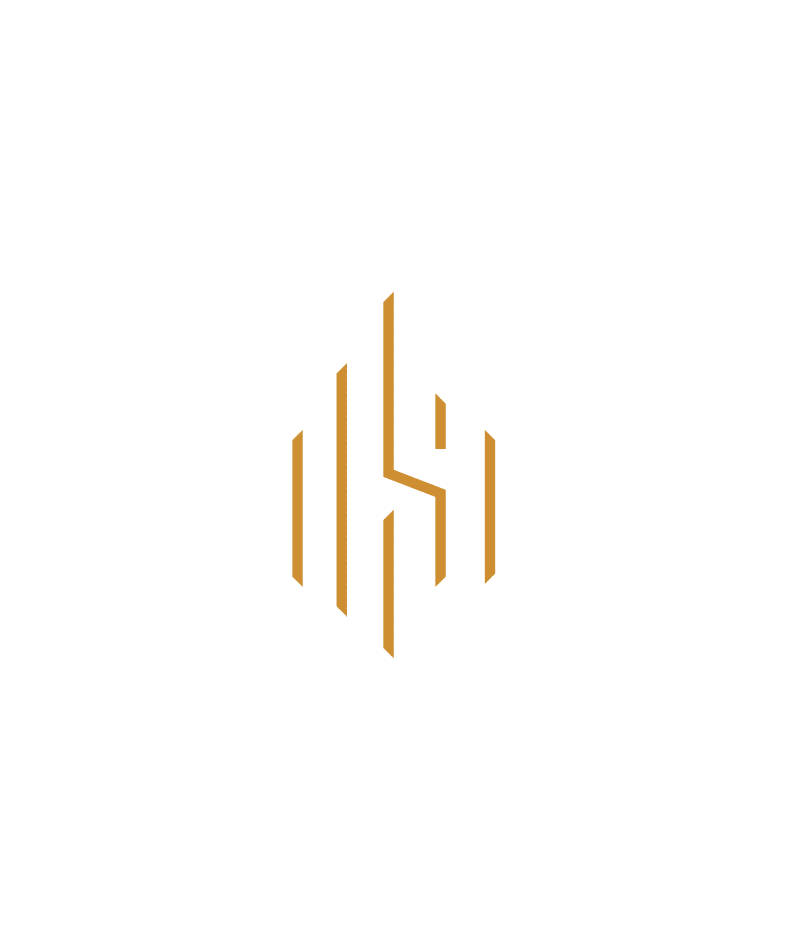Risque de liquidité : quand vendre devient plus difficile que prévu
Dans l’univers de l’investissement, on pense souvent à la rentabilité, au risque de perte, à la fiscalité. Mais un autre facteur, discret et pourtant essentiel, conditionne notre capacité à utiliser notre argent : la liquidité.
Ce terme désigne la facilité avec laquelle un actif peut être vendu ou transformé en liquidités sans perte excessive de valeur. Et lorsque cette facilité disparaît, on parle alors de risque de liquidité.
Ce risque n’est pas toujours visible à l’achat. Il se révèle souvent au moment où l’on souhaite récupérer son capital. Et à ce moment-là, il peut contraindre, ralentir ou même bloquer une opération prévue. Il concerne autant les investisseurs prudents que les profils plus dynamiques, car il ne dépend pas uniquement du risque financier, mais du fonctionnement du marché lui-même.
Ressources pour aller plus loin
- Évaluez la liquidité réelle de vos placements actuels
- Lire : Faut-il privilégier des placements liquides dans un contexte incertain ?
- Parler à un conseiller pour réorganiser son patrimoine selon ses besoins de disponibilité
FAQ – Risque de liquidité : ce qu’il faut savoir avant d’immobiliser son argent
Qu’est-ce que le risque de liquidité en investissement ?
C’est le risque de ne pas pouvoir revendre un actif rapidement, ou sans perte importante, lorsque l’on a besoin de son argent. Il peut résulter d’un marché peu actif, d’un manque d’acheteurs, de règles de sortie contraignantes, ou de délais administratifs. Ce risque peut transformer un bon placement sur le papier en source de frustration ou de tension financière, si la sortie ne peut pas se faire dans les temps.
Quels sont les placements les plus concernés ?
Les actifs immobiliers, les SCPI, les titres non cotés, les parts de fonds fermés ou certains produits structurés figurent parmi les supports les moins liquides. Il peut s’écouler plusieurs semaines, voire plusieurs mois, entre la demande de rachat et la réception effective des fonds.
L’assurance-vie peut aussi présenter une liquidité limitée selon les supports choisis. Même des produits bancaires classiques peuvent être soumis à des délais de préavis. À l’inverse, les actions cotées, les ETF ou les livrets d’épargne sont en général très liquides, permettant une récupération rapide du capital.
Pourquoi ce risque est-il souvent sous-estimé ?
Parce qu’il ne se manifeste qu’au moment de la sortie. Tant que tout va bien, l’épargnant n’y pense pas. C’est seulement lorsqu’un besoin urgent de liquidité se présente — achat, imprévu, succession, opportunité — que l’on se rend compte qu’un placement est immobilisé.
Ce décalage entre perception et réalité rend le risque de liquidité invisible jusqu’au moment critique. C’est pourquoi il est essentiel de le prendre en compte dès la phase de choix du placement, pas uniquement en fin de parcours.
Peut-on éviter totalement ce risque ?
Non, sauf à n’investir que dans des supports 100 % liquides, comme les livrets réglementés ou les comptes courants. Mais cela revient à sacrifier toute perspective de performance à long terme.
La solution n’est donc pas de l’éviter, mais de le gérer stratégiquement. Cela passe par une allocation équilibrée entre supports liquides et supports plus rémunérateurs mais moins accessibles. Il s’agit aussi d’anticiper ses besoins futurs pour ne pas se retrouver contraint de vendre dans de mauvaises conditions.
Comment structurer un patrimoine en tenant compte de la liquidité ?
l est conseillé de toujours conserver une réserve de sécurité disponible rapidement, souvent placée sur des supports liquides et sûrs. Ensuite, les autres couches du patrimoine peuvent intégrer des placements moins liquides, mais mieux rémunérés, en adéquation avec des projets à plus long terme.
Un bon équilibre repose sur la connaissance de ses priorités : disponibilité, rendement, transmission, optimisation fiscale. C’est la cohérence d’ensemble qui permet de tirer parti des avantages de chaque support, sans subir leurs inconvénients en cas d’imprévu.